
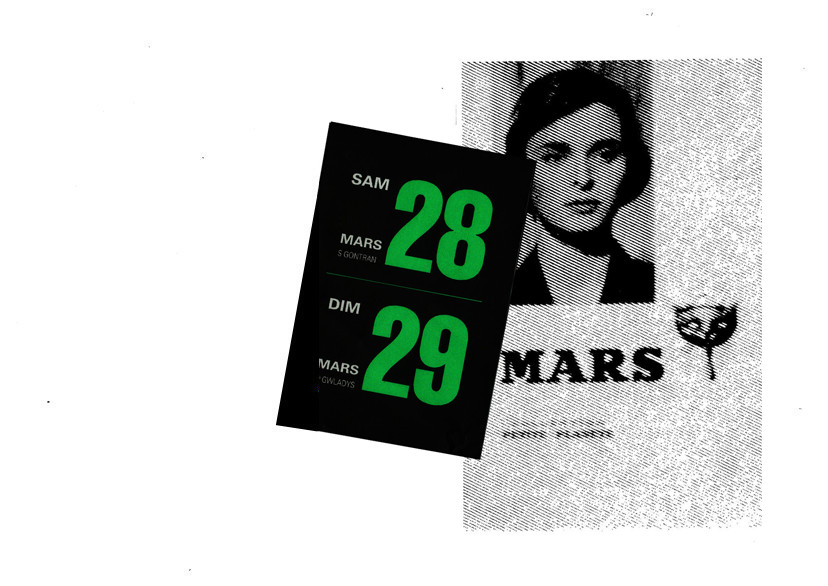


Cette nuit je n’ai pas dormi à cause d’un camion qui pleurait.
Il était garé dans la rue,
à quelques mètres de la fenêtre entrouverte
à cause de la chaleur.
Il n’avait rien du petit duc familier
celui qui chante inlassablement au-dessus du toit
dans les arbres éveillés par la lune
l’humidité rassurante de la nuit
la chaleur moite du mois d’aout touchant à sa fin et caressant
l’embrasement des massifs luisants, de la végétation fatiguée.
Se retourner dans des draps trop mous ou trop durs,
sans trouver comment s’assoupir,
sentir une ivresse souterraine envahir petit à petit
ce que la noirceur de la chambre apporte comme consistance
à une pensée éparpillée par le sommeil. Les rêves se meuvent en présences.
Toute distinction est impossible à moins de s’extraire de ce moment si incompatible avec le présent. Les formes sont lumières et couleurs inventées, séductrices dans l’obscurité. Elles suggèrent plus que ne sont vraiment. Les odeurs ont disparu. Le mouillée de la terre devient un bruit sauvage. Il n’y a pas de vent du tout, ou plutôt il n’y a pas d’air. L’air a emporté les odeurs avec lui et ce que je savais être l’odeur familière de la chambre, du lit et la peau, de la sueur et du sommeil n’existe plus, comme si la torpeur les avait estompées, étirées ou dilatées.
Il n’y plus que le bruit, réel et lancinant.
Il perce toutes les obscurités pour se loger contre moi,
frapper mon oreille, déchiré.
C’est son un qui tourne, du début à la fin.
Si l’on écoute assez fort,
on se rend compte qu’il commence par un T et fini par T
ET toute cette ronde de T est entrecoupée de hOU.

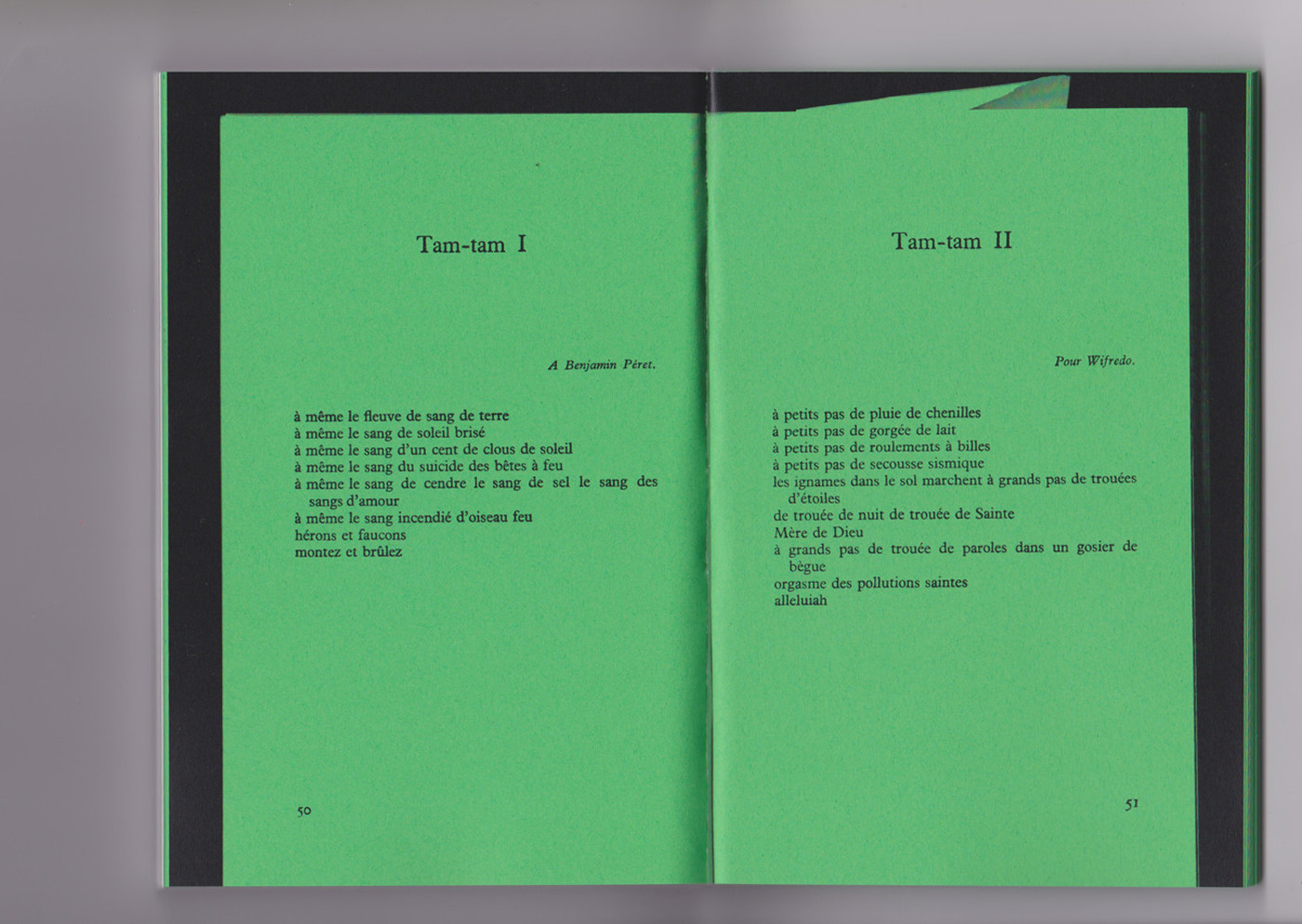
avec
Lou-Maria Le Brusq